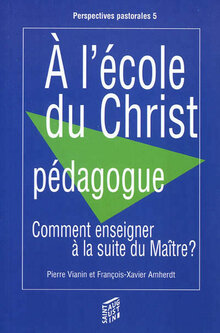Le livre de l’Apocalypse, rédigé au tournant du 1er siècle de notre ère, enchaîne les visions tour à tour lumineuses et terrifiantes, espérant de ses lecteurs et auditeurs un engagement résolu à la suite du Christ, Agneau immolé et vainqueur. Tout est vu du « ciel », lieu qui domine la création et qui n’est descriptible que par touches impressionnistes. L’univers céleste, accessible par la seule bienveillance divine, est à différencier du ciel visible qui, avec la terre et la mer, est l’espace occupé par les humains. La cosmographie renvoie ici à la Genèse, Dieu ayant suscité, pour les êtres vivants, un ciel au deuxième jour de la création, la terre et la mer au troisième (1,8.10).
Selon l’Apocalypse, ce monde visible, miné par les puissances du mal et jugé par Dieu, va craquer et disparaître pour laisser place à un monde régénéré de fond en comble. Le ciel et la terre sont nouveaux et « la mer n’est plus » (21,1). Pour l’Apocalypse, livre chrétien tissé de motifs juifs tramés d’éléments grecs, la mer est en effet le lieu de toutes les richesses et de tous les dangers.
L’au-delà de la blancheur marine
Jean, le visionnaire de l’Apocalypse, est exilé à Patmos (1,9), l’une des nombreuses petites îles du Dodécanèse au large de la côte asiate. C’est un pied sur la mer et un autre sur la terre qu’un « ange puissant » lui donne un petit livre mystérieux (10,2-8). Par tradition juive, il n’ignore pas que terre et mer sont nées, au troisième jour, du même acte créateur (Gn 1,9-10). Par culture grecque, il sait qu’elles constituent, selon Sophocle (vers 441 av. J.-C.), l’espace différencié et complémentaire de l’homme :Vers l’au-delà de la blancheur marine,
Confiant sa voile à la vitesse des tempêtes,
Sur le mouvant gonflement des vagues mugissantes,
Il s’élance et franchit l’abîme.
Et la plus grande des déesses,
Immortelle, la Terre, inépuisable, inlassable,
Année après année, il la fatigue, il la féconde
Sous le va-et-vient des bœufs et des charrues.
Navigateur et cultivateur, l’homme est par nature audacieux, téméraire, déterminé. Il ose, dompte, pense, parle et construit les villes. Dans l’Antiquité méditerranéenne, quelle grande ville n’a pas son port ? Alexandrie, Carthage, Gadès (Cadix), Marseille, Syracuse, Corinthe, Éphèse, Antioche, Tyr acheminent par mer les produits de la terre. C’est ainsi qu’au Ier siècle de notre ère, convergent vers Rome, « la » ville, les « richesses des climats divers ». Et Rome, sans aucun doute, est visée lorsque Jean dessine Babylone, la « grande prostituée qui réside au bord des grandes eaux », la « grande cité qui règne sur les rois de la terre » (Ap 17,2.18).
Quand celle-ci s’écroule, Jean lance un chant funèbre entonné successivement par ces mêmes rois puis par les « marchands de la terre », les « pilotes et les travailleurs de la mer ». « Réjouis-toi, ciel ! », commente-t-il, car « l’opulence qui a enrichi tous ceux qui ont des vaisseaux sur la mer » s’effondre avec ses cargaisons d’or, de pierres précieuses, d’épices, de vins, d’huile, d’étoffes, de bétail et d’esclaves (Ap 18,9-24).
Commerces et trafics avaient été condamnés par Virgile, Horace ou Cicéron, spontanément hostiles aux gens de mer qu’ils estimaient dépravés. Jean, lui, ne porte pas de jugement moral. Prophétique, il se situe dans la mouvance d’Ézéchiel qui avait dénoncé l’arrogance de la ville de Tyr (Ez 26,1–27,36), laquelle était le « symbole de tout peuple, quel qu’il soit, qui tire orgueil de ses entreprises au point de bâtir sur elles le fondement de son existence ».
Jean va plus loin qu’Ézéchiel. Confiante en elle-même et en ses richesses, allégorie ou métaphore de Rome, Babylone la Prostituée ne voit pas le danger qui est sous ses pieds. Elle est assise « sur une bête écarlate, couverte de noms blasphématoires, avec sept têtes et dix cornes » (Ap 17,3). Ce monstre va se retourner contre elle et la déchiqueter (17,16-17). Or ce monstre ressemble fort à la Bête de la mer.
Dans les visions de l’Apocalypse, cette Bête est la première des deux puissances infernales suscitées par le Dragon céleste des origines (13,1-18). Elle symbolise l’impérialisme politique. Blasphématoire, elle s’oppose à Dieu et au Christ. Idolâtre, elle demande de vénérer ses images – vénération qualifiée par Jean de « prostitution ». La deuxième Bête, celle de la terre, est toute à sa dévotion. Comme le Dragon, comme la Bête de la mer, elle est vaincue dans un combat final (19,20 ; 20,10). Alors, conclut Jean, « la mer rendit ses morts » (20,13).
Dans le monde nouveau espéré pour la fin des temps, « la mort ne sera plus ». Et, avec la mort, avec la multiplicité des trafics et des mensonges, avec l’idolâtrie, c’est la mer qui disparaît. Sur la terre renouvelée, la « cité sainte » descend du ciel (Ap 21,1-4). Pour nourrir les nations, il suffit d’« un fleuve d’eau vive » (22,1-3). Plus besoin de bateaux, de comptoirs et de voies maritimes. Plus besoin de flottes impériales. Les grandes batailles navales, de Salamine à Actium, appartiennent au passé. Un trône et un Agneau suffisent à maintenir l’ordre du monde et la paix universelle.
Rêveries de navigateurs et de prophètes
Dans l’Apocalypse comme dans le reste de la Bible, la mer, au contraire de la terre, est un espace beaucoup plus mythique et historique qu’eschatologique.Selon son dessein, le Très-Haut a dompté l’Abîme,
Il y a planté des îles.
Ceux qui naviguent sur la mer en décrivent les périls,
Nous n’en croyons pas nos oreilles.
Et là, ce sont choses étranges, merveilleuses,
Animaux de toute sorte
Et monstres marins de la création. (Si 43,23-25)
Le propos est d’expérience. Sur la mer, rien n’est banal et les récits s’enflent avec la houle. L’Abîme est cette étendue mouvante des eaux qui entourent la terre, insondables et ténébreuses, comme un résidu du tehom primordial et chaotique (Gn 1,2) – il correspond, peu ou prou, à la « mer extérieure » de la carte géographique de Strabon (fin du Ier siècle de notre ère). La mer comme telle est plus accueillante que l’Abîme. Apparue, comme la terre, de la séparation des eaux (troisième jour, Gn 1,9-10), elle est dotée d’un grouillement d’animaux mais aussi de monstres marins (cinquième jour, Gn 1,20-23). L’existence de ceux-ci semble un fait et la peur devant l’Abîme se reporte souvent sur eux – Jonas est avalé par un « gros poisson » (Jon 2,1).
Léviathan fait-il partie des périls sur lesquels les marins colportent des légendes ? Indomptable et « roi sur tous les fauves », son nom donne forme mythique au danger des profondeurs (Jb 40,25–41,26 ; Ps 74[73],14). Seul le Créateur a pouvoir sur lui :
Par sa force, [Dieu] a dompté la mer
Et, par son intelligence, écrasé le Monstre marin.
Par son souffle, il a rendu le ciel serein,
Sa main a transpercé le Serpent fuyard. (Jb 26,12-13)
Le mythe est transporté par le prophète Isaïe à la fin de l’histoire, le récit des derniers temps établissant une boucle avec celui des origines :
Ce jour-là, le Seigneur interviendra
Avec son épée acérée, énorme, puissante,
Contre Léviathan, le Serpent fuyant,
Contre Léviathan, le Serpent tortueux.
Il tuera le Dragon de la mer. (Is 27,1)
Affirmer crânement la maîtrise divine rassure les auditeurs du prophète et les invite à discerner, ici et maintenant, d’autres hauts faits salvifiques. Différents encore du miracle de la Mer (Ex 14), « chemin en pleine mer, sentier au cœur des eaux déchaînées » (Is 43,16), ils sont moins spectaculaires, plus quotidiens. L’histoire présente et la Création comme telle sont aussi des actes de Salut :
Voici l’immensité de la mer,
Son grouillement innombrable d’animaux grands et petits,
Ses bateaux qui voyagent,
Et Léviathan que tu fis pour qu’il serve à tes jeux. (Ps 104[103],25-26)
Ce psaume parle de « la » mer. Sans doute pense-t-il à la Méditerranée – appelée « la grande mer » (Nb 34,6) ou « mer occidentale » (Dt 11,24). Mais ce pourrait être tout aussi bien le Nil (Is 19,5) ou l’Euphrate (Jr 51,36), voire la « mer de Kinnéreth » (Nb 34,11 ; pour nous, elle n’est qu’un lac). Seule la mer Morte est exclue, aucune vie n’étant possible à cause de son exceptionnelle salinité. En hébreu, un mot unique, yam, désigne toutes ces réalités : mer, fleuve ou lac, bref toute étendue d’eau profonde…
Et puis, il y a le yam d’airain ou de bronze dans la maison du Seigneur, le Temple édifié par Salomon (1 R 7,23-26.39 ; 2 Ch 4,2-7). Comme l’ensemble de la Maison, la « Mer de métal fondu » (dont les dimensions contredisent la capacité) ne subsiste plus que dans l’écriture poétique des livres des Rois et des Chroniques. Représentation symbolique de l’Abîme et figure des anciennes frayeurs ? À supposer qu’il en soit ainsi, alors le culte dont cette Mer métallique est l’une des composantes – énigmatique, il est vrai – serait déjà appréhension et maîtrise des éléments, hommage à la puissance divine et appel à la confiance. Depuis 587 av. J.-C., l’objet a été brisé par les marteaux des Chaldéens (2 R 25,13) ; et, depuis 70 de notre ère, le culte a cessé avec l’incendie du Temple par le général Titus. Mais il en reste le récit. Le pouvoir des récits n’est pas moindre, il est autre.
Il y a les terreurs maritimes et les récits des marins. Il y a la mémoire liturgique et sacramentelle des récits bibliques. Il y a enfin l’utopie des visions prophétiques.
Dans son exil douloureux, méditant le passé et se laissant conduire dans le futur, le prophète Ézéchiel reconstruit en rêve la Maison (Ez 40–47). La Mer, autrefois sculptée par Hiram et ses orfèvres, laisse place à une source vive qui sort « de dessous le seuil de la Maison, vers l’orient » et descend « au bas du côté droit de la Maison, au sud de l’autel » (47,1). L’eau devient torrent, traverse le désert et se jette « dans la mer » (la mer Morte, la version syriaque ajoute « dans ses eaux nauséabondes »). Le prophète est alors le témoin ébahi d’une reprise de la Création du monde :
Le poisson sera très abondant, car cette eau arrivera là et les eaux de la mer seront assainies : il y aura de la vie partout où pénétrera le torrent. Alors des pêcheurs se tiendront sur la rive ; et, depuis Ein-Guèdi jusqu’à Ein-Eglaïm, ce sera un séchoir à filets. Les espèces de poissons seront aussi nombreuses que celles de la grande mer. (Ez 47,9-10)
La fécondité des eaux ne vient pas de la mer elle-même. Elle vient de l’extérieur, elle vient du cœur de la Maison, demeure du Seigneur au milieu de son peuple. Pour accentuer la chose, le torrent dévale et, sur ses rives, fleurissent des arbres dignes du jardin de l’Éden : fruits à foison et feuilles médicinales. N’a-t-on pas là des « choses étranges » qui dépassent en merveille les récits des marins ? L’utopie prophétique fait sens : en attendant la revivification de la mer Morte, la « grande mer » n’est qu’un réservoir, un immense vivier. La vie, la vraie vie, est ailleurs.
En haute mer
« Qui est-il, celui-ci, pour que même les vents et la mer lui obéissent ? » (Mt 8,27). L’interrogation des disciples devant Jésus maîtrisant les vagues par sa parole a sa réponse dans la foi de l’Église. La « mer » est ici celle de Kinnéreth appelée « de Galilée » ou « de Tibériade » (voir Jn 6,1). Avec son rivage, elle constitue le cadre premier de la proclamation de l’Évangile (Mc 1,14-16 ; Mt 4,12-18).Cette mer aux contours étroits résume toutes les autres mers. Et permet le dévoilement de l’identité de Jésus.
En calmant la tempête (Mc 4,35-41 ; et parallèles), en marchant sur la mer (Mc 6,45-51 ; et par.), Jésus laisse apparaître ce qui l’unit au Créateur qui dompte les eaux et rend au ciel sa sérénité (voir Jb 26,12-13). En autorisant les esprits impurs à entrer dans le corps d’animaux impurs (les cochons) qui se précipitent dans la mer et rejoignent les monstres des profondeurs, il remet le monde en ordre (Mc 5,1-13 ; et par.). En bénissant et faisant distribuer pains et poissons (Mc 6,30-44 ; Mc 8,1-10 ; et par.), il magnifie les produits locaux, ceux du sol et ceux des flots. Par la pêche miraculeuse, enfin, du moins celle qui se déroule dans la lumière de la Résurrection (Jn 21,1-11), il exalte les eaux prolifiques, celles du cinquième jour originel (Gn 1,20.22) et celles du monde à venir, Sanctifiées par la source qui coule du côté droit du sanctuaire (Ez 47,1.10) ou du côté du Crucifié (Jn 19,34).
Mais ce n’est pas tout. La pêche miraculeuse, racontée par Luc, dévoile, outre la mission de Jésus, celle des Apôtres, en particulier de Simon-Pierre. Certes, Luc ne parle pas de la « mer » (thalassa, en grec) mais du « lac » de Gennésareth (limnè, en grec ; Lc 5,1). Le lieu devient parabole. S’y concentrent les harmoniques des voyages apostoliques à venir de Pierre et de Paul. Il suffit de quatre mots : epanagage eis to bathos… Ce syntagme polysémique peut signifier : « Avance en eau profonde… », ou bien : « Va au large… » (Lc 5,4).
Avancer en eau profonde, c’est aller là où il y a possibilité de trouver du poisson. Mais c’est aussi cingler vers le danger et risquer de rencontrer Léviathan. Le bénéfice espéré vaut-il le risque pris ? Malgré son diagnostic, Simon se lance. Il le fait non par calcul mais avec confiance en la parole de Jésus.
Aller au large (en pleine mer, en haute mer), c’est affronter l’inconnu, quitter le rivage des certitudes, espérer du nouveau, de l’inédit. Qui ose l’aventure sur la parole de Jésus éprouve une sortie de soi, traverse la fatigue de la nuit et, déjà, avant tout résultat, fait l’expérience d’une renaissance.
Ce double mouvement se retrouve dans les Actes des Apôtres. Paul emprunte bien des bateaux. Qu’il suffise de relire son premier voyage : « Envoyés en mission par le Saint Esprit, Barnabas et Saul descendirent à Séleucie, d’où ils firent voile vers Chypre… » (Ac 13,1–14,28). Avançant en profondeur, ils sont allés très loin dans l’interprétation des Écritures, provoquant en retour la colère de leurs auditeurs juifs et plusieurs lapidations quasi mortelles (14,19). Allant de l’avant, ils se sont laissés mener par les circonstances, rien ne paraissant avoir été planifié. Pour quel résultat ? Tout simplement l’œuvre à laquelle l’Esprit les avait destinés (13,2), à savoir l’ouverture « aux païens des portes de la foi » (14,27). Que serait-il advenu s’ils s’étaient défiés du saint Esprit et s’ils n’avaient pris la mer ?
* * *
Selon l’Apocalypse, à la fin des temps, la mer, dénaturée par la Bête qui en est sortie, est rayée du monde nouveau. Elle disparaît avec la nuit, la mort, les larmes et le deuil. Pourtant, il subsiste quelque chose d’elle, le meilleur, métamorphosé, sublimé. Sa fonction nourricière est désormais assumée par « un fleuve d’eau vive »
(Ap 22,1-4). La vision d’Ézéchiel, épurée, active la mémoire du jardin de l’Éden : eau, fruits et feuilles qui guérissent sont offerts à tous, largement disponibles. Avec un bel oxymore – eau et roche –, Jean précise que le fleuve est « brillant comme du cristal ». Son éclat, en quelque sorte, réfléchit celui de la « cité sainte » avec ses gemmes, ses pierres précieuses, sa place « d’or pur, comme un cristal limpide » (21,11-21). La comparaison vient de la vision céleste inaugurale où, devant le trône divin, il y a « comme une mer de verre, semblable à du cristal » (4,6). Une mer de verre ! Immense, translucide, scintillante, elle contredit la mer des trafics et des dangers. Plus loin, sur un espace « comme une mer de cristal mêlée de feu » (15,2), le jugement définitif de la Bête de la mer s’annonce…