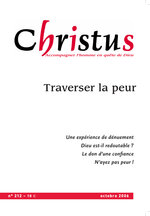Le besoin de sécurité revient souvent sur nos lèvres dès qu’il est question de la peur. Le mot est en lui-même aussi ancien que la langue française, mais tous ceux qui en dérivent (« sécuriser », « sécurisant », « sécurisation », « sécuritaire ») sont apparus il y a une trentaine d’années, parfois moins. C’est dire l’importance que nous donnons à cet état d’esprit, dont les hommes politiques de tout bord se sont largement emparés.
Le P. Trublet est professeur d’Ancien Testament et aumônier de l’École des officiers de la gendarmerie nationale depuis huit ans. Auditeur de la XIVe session nationale de l’INHES (Institut National des Hautes Études pour la Sécurité), son point de vue sur ces questions est un précieux témoignage sur ce corps militaire.
Christus : Qu’est-ce qui motive un jeune à entrer en gendarmerie ?
Jacques Trublet : Le service de ses
Le P. Trublet est professeur d’Ancien Testament et aumônier de l’École des officiers de la gendarmerie nationale depuis huit ans. Auditeur de la XIVe session nationale de l’INHES (Institut National des Hautes Études pour la Sécurité), son point de vue sur ces questions est un précieux témoignage sur ce corps militaire.
Christus : Qu’est-ce qui motive un jeune à entrer en gendarmerie ?
Jacques Trublet : Le service de ses