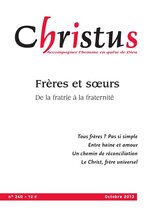D’avoir les mêmes parents nous fait frères et sœurs, créant un lien tout à fait unique qui porte en lui-même et à la même mesure les germes potentiels du meilleur… comme du pire. En effet, ce qui nous lie aux parents, dans le besoin que nous avons tous d’être reconnus et aimés, devient le lieu même d’une rivalité qui peut se faire féroce si pointe le sentiment (subjectif ? objectif ?) qu’un « autre » est préféré. Or, pour le petit enfant, le monde se présente au départ en tout ou rien, en tout-bon ou tout-mauvais : jusque-là, dans un besoin fusionnel, « lui » (le parent), c’est « moi », et voici que désormais, avec cet intrus, pointe l’évidence inverse : si c’est « lui » (le petit frère), ce ne peut plus être « moi ».
Le psychanalyste J.-B. Pontalis écrit :
C’est précisément cette souffrance d’une équation contradictoire provoquée par l’arrivée d’un rival qui va obliger chacun à interroger ses illusions d’omnipotence et à se poser des questions :
– Mais aussi et surtout souffrance qui oblige à chercher une issue à cette concurrence pour l’amour de la mère, puis des parents. Et les enjeux sont ici existentiels : au creux de cette rivalité fraternelle, qui va ou non permettre le maniement de l’agressivité dans l’accès à l’ambivalence, commence à se poser une double question concernant ma propre identité. Me demander :