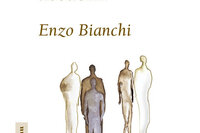Remi de MAINDREVILLE s.j.
Ceux qui refusent l’héritage catholique s’appuient souvent sur une tradition rationaliste et agnostique, enrichie par l’évolution permanente des sciences et des techniques. Cette tradition contribue à soutenir une mise à distance des prétentions religieuses, en particulier des religions révélées dont les affirmations ne peuvent être validées avec la même rigueur de raison. Se poursuit ainsi une vision de l’homme et du monde attirante et efficiente, loin du discours et de la vie des religions dont l’approche nécessiterait alors, chez les personnes intéressées, une motivation et une volonté fortes. C’est plus souvent à partir d’autres dimensions de l’existence, comme la vie affective ou l’intérêt spirituel, ou encore le sens de la vie, qu’une telle approche s’envisage concrètement. Dans ce court article, nous envisagerons trois attitudes différentes de refus de l’héritage, et certaines conséquences qui en découlent.
Méfiance et désaffection
Depuis quelques années, des personnes demandent de façon explicite et motivée d’être rayées des registres de baptême de l’Église catholique. On y décrypte la déception profonde, l’agressivité parfois, devant des comportements de ministres ou de responsables d’Église, ou encore devant des attitudes jugées trop intransigeantes de l’Église comme