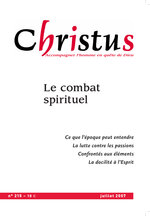Pour nombre de nos contemporains, mis à part quelques initiés, le terme de « combat spirituel » s’accompagne d’une résonance étrange. À voir leur perplexité, on se croirait devant une notion effondrée, disparue sans bruit du paysage social et intime. Autour de ces deux mots qui furent si parlants, ne demeure qu’une série d’images surannées, comme autant de vestiges d’un patrimoine religieux englouti : mystiques tourmentés, ascètes, pénitents excessifs, fous de Dieu aujourd’hui redoutés… Dans ces lambeaux d’images, le désert figure encore en bonne place, avec son lot de tentations et de solitude. La résistance au démon, le combat avec l’ange, les affres de la nuit subsistent à l’état de traces, mais on ne souhaite guère s’y appesantir à cause du soupçon de la négation de soi, qui semble aujourd’hui une faute grave, un déni du réel, une impasse sacrificielle. Et le désert, si son image surgit à l’évocation du combat spirituel, n’est qu’un « vieux » désert ! Car le désert de nos imaginaires collectifs actuels offre d’autres perspectives. Il serait plutôt celui de la grande réconciliation avec soi, avec le monde, avec Dieu ; le lieu d’un nouveau pacte et d’une paix reconquise ; le lieu de l’adoration rayonnante. La bonne « coupure », la saine solitude, la halte salutaire. Quant au mystique, on lui voit plutôt le sourire du Bouddha, un sourire « décroché », flottant mystérieusement très au-dessus de la mêlée.
Serions-nous donc devenus si étrangers aux combats, si imperméables à Dieu, si fermés au spirituel ? Sûrement pas ! Les combats et la spiritualité sont encore bien dans nos vies : nous sommes, de fait, contraints à des combats dont nous nous passerions, dans notre vie quotidienne — pour notre insertion dans la société, nos relations de travail, le sentiment de notre propre existence, contre la précarité sous toutes ses formes… — et nous sommes
Serions-nous donc devenus si étrangers aux combats, si imperméables à Dieu, si fermés au spirituel ? Sûrement pas ! Les combats et la spiritualité sont encore bien dans nos vies : nous sommes, de fait, contraints à des combats dont nous nous passerions, dans notre vie quotidienne — pour notre insertion dans la société, nos relations de travail, le sentiment de notre propre existence, contre la précarité sous toutes ses formes… — et nous sommes