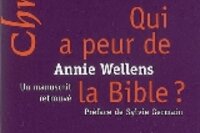Le 7 janvier dernier, les représentants de l’Église catholique et ceux de l’État décidaient, lors de leur rencontre annuelle, de créer un groupe de travail sur « le statut des laïcs engagés dans des activités pastorales » 1. Et sans attendre, la ministre de l’Intérieur et des Cultes, Michèle Alliot-Marie, suggérait la création d’un « contrat de volontaire religieux », calqué sur celui existant pour le monde associatif.
En plein regain du débat sur la laïcité, une telle « négociation » entre l’Église et l’État aurait pu faire réagir. Il n’en a rien été. Le sujet est-il trop technique, ou ne concerne-t-il que trop peu de personnes ? Pourtant, il serait intéressant de se demander pourquoi l’Église sollicite un statut dérogatoire du droit commun pour celles et ceux qu’elle emploie dans ses diocèses et ses paroisses. Au regard du droit du travail, les laïcs qui exercent de façon permanente des fonctions ecclésiales (aumôneries, catéchèse…) concluent un contrat à durée indéterminée ; en revanche, vis-à-vis de l’Église, ils agissent dans le cadre d’une « lettre de mission » dont le retrait entraîne résiliation du contrat. D’où d’inévitables frictions, que les conseils de prud’hommes ont parfois eu à connaître ces dernières années…
En plein regain du débat sur la laïcité, une telle « négociation » entre l’Église et l’État aurait pu faire réagir. Il n’en a rien été. Le sujet est-il trop technique, ou ne concerne-t-il que trop peu de personnes ? Pourtant, il serait intéressant de se demander pourquoi l’Église sollicite un statut dérogatoire du droit commun pour celles et ceux qu’elle emploie dans ses diocèses et ses paroisses. Au regard du droit du travail, les laïcs qui exercent de façon permanente des fonctions ecclésiales (aumôneries, catéchèse…) concluent un contrat à durée indéterminée ; en revanche, vis-à-vis de l’Église, ils agissent dans le cadre d’une « lettre de mission » dont le retrait entraîne résiliation du contrat. D’où d’inévitables frictions, que les conseils de prud’hommes ont parfois eu à connaître ces dernières années…
La « doctrine du mandat »
Ce n’est pas ici le lieu de trancher les éventuelles contradictions entre le