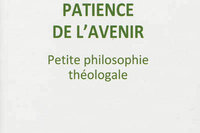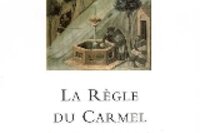Marguerite Léna
Philosophe, communautéSaint François-Xavier,
Centre Sèvres et Faculté Notre-Dame, Paris. A publié chez Parole et Silence :
Le passage du témoin : éduquer, enseigner, évangéliser (1999), L’esprit de l’éducation (2004) et Une plus secrète lumière : Méditations pour l’année liturgique (avec R. de Feraudy, 2010).Cet article reprend et développe une intervention prononcée au Collège des Bernardins en avril 2011 dans le cadre d’un débat sur la confiance.
Dernier article paru dans Christus : Éduquer, c’est espérer » (n° 230HS, mai 2011).
Le 11 mars dernier, la terre a tremblé au Japon, et nul ne peut aujourd’hui mesurer l’ampleur de ce désastre. M’est alors venu à l’esprit un propos de Pascal évoquant la situation de l’homme dans un univers désormais sans centre ni repère : « Tout notre fondement craque, et la terre s’ouvre jusqu’aux abîmes » (1). Il ne parlait pas d’un tremblement de terre. Il parlait de la condition humaine permanente, mais d’une condition habituellement voilée par l’immense effort des cultures pour aménager, habiter et embellir le monde. Les événements du Japon ont comme déchiré ce voile, apportant à notre « société de défiance » de nouvelles raisons de soupçonner la science, la technique, la politique, et jusqu’à la nature elle-même. Ce qui désormais craque, vacille et se dérobe, c’est le fondement de confiance sur lequel reposent nos institutions démocratiques, notre goût d’agir, notre élan vers l’avenir et vers autrui.
Or, je constate qu’à travers les diverses enquêtes portant sur ce thème, la notion de confiance est objectivée, quantifiée, traitée comme une variable statistique et un paramètre de la vie collective. De l’économie à la météo, on définit des « indices de confiance » chiffrés. En mécanique, en informatique, on parle de la « fiabilité » des matériaux et des systèmes ; on la teste et on la mesure. Ce sont là de précieux outils de prévision, de calcul des risques
Or, je constate qu’à travers les diverses enquêtes portant sur ce thème, la notion de confiance est objectivée, quantifiée, traitée comme une variable statistique et un paramètre de la vie collective. De l’économie à la météo, on définit des « indices de confiance » chiffrés. En mécanique, en informatique, on parle de la « fiabilité » des matériaux et des systèmes ; on la teste et on la mesure. Ce sont là de précieux outils de prévision, de calcul des risques