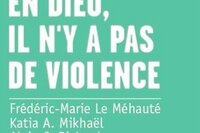Quand nous parlons de repos, du difficile repos, nous considérons le faire et l’agir : les activités, les réalisations, les projets, etc. tout ce qui nous pousse à courir et à nous presser sans cesse, parfois jusqu’à l’épuisement. Se reposer semble mettre tout cela entre parenthèses. Mais est-ce possible ? Pour les professionnels très occupés que nous sommes, les devoirs de la vie quotidienne, le travail et les obligations sociales nous rattrapent toujours. Il arrive parfois que nous nous y épuisions et que nous perdions le sentiment d’exister en dehors de l’action.
Les pages qui suivent donnent la parole à des personnes très diverses qui se sont mises en recherche de postures et de moyens pour rendre leur vie plus équilibrée, plus humaine, au cœur de mille occupations.
Patrick, entrepreneur
Nous avons souvent tendance à opposer l’action à l’être. Or, peut-on vraiment faire sans être ? L’action n’est-elle pas le creuset où l’être peut grandir ? Nous en faisons l’expérience tous les jours : c’est en construisant notre part du monde que nous prenons conscience de ce que nous sommes. Cela dit, le repos ne nous permettrait-il pas de relâcher notre attention et nos énergies, appliquées d’habitude à l’action, pour prendre conscience de ce qui, en nous, est de l’ordre de l’être ?
C’est seulement à partir de la deuxième moitié du XXe siècle que les vacances, dans nos sociétés occidentales, sont devenues un temps de loisir et de repos. Auparavant, ce que nous appelons « vacances » permettait les activités agricoles telles les vendanges, la célébration des grandes fêtes religieuses comme Noël et Pâques, et la mémoire des événements de notre histoire collective. La culture de l’industrie et de l’entreprise a introduit un clivage conceptuel entre l’action et le repos, qui s’élargit de plus en plus. Progressivement, nous avons inscrit le repos dans nos lois, comme une avancée importante du respect de la dignité humaine, et en particulier de celle des travailleurs.
Je suis entrepreneur et il me semble qu’aujourd’hui, pour une personne qui a une activité professionnelle intense, le repos est un défi non pas tant au plan législatif que dans son rapport au travail. Ce défi pourrait se décliner en ces termes : Comment le travail permet-il une activité féconde sans épuiser les personnes ? Comment les temps de repos légalement institués permettent-ils réellement de décrocher du travail et de faire émerger chez les grands travailleurs ce qui relève de l’être ?
Anne-Lyse, infirmière
J’ai souvent entendu dire, et j’en ai la profonde conviction, que la qualité d’une vie se mesure à celle des relations que nous engageons au fil des jours, dans les différents lieux que nous habitons. La qualité de vie au travail ne fait pas exception. Soigner les relations formelles et informelles est certes le devoir de tous, employés comme directeurs. Encore faut-il qu’un cadre soit mis en place pour prendre en compte l’aspect collectif du travail et de la production, la proximité et la participation. Comment est-ce que je m’y engage ? Il me semble fondamental de considérer mon collègue, quel qu’il soit, non comme un collaborateur provisoire ni, encore moins, comme un concurrent, mais comme une personne avec qui je dois chercher à engager des relations de respect et de confiance pour lui, pour moi et pour le projet collectif. Ceci me semble d’autant plus fondamental que le temps que je passe au travail est très important, et que ma vie relationnelle à l’extérieur en pâtit.
Je suis infirmière, épouse et mère de trois enfants. Il m’arrive de devoir travailler les week-ends alors que mon petit monde est à la maison. Le temps des vacances est essentiel pour ma famille. Nous choisissons souvent de partir, mais pas toujours. C’est le moment par excellence où nous soignons les liens entre nous. C’est le moment où je peux signifier à mes proches qu’ils passent avant le travail, ce qui n’est pas évident dans la vie quotidienne ; le moment où je parle d’eux, de moi, de nous, et non des patients que j’ai quittés. Ce n’est pourtant pas seulement un temps pour moi et ma famille, ce qui serait en soi légitime, ni un remède à mon éventuelle culpabilité, mais le temps de la confiance, pour affermir des liens et une complicité qui nous font grandir, et sur lesquels nous pouvons nous appuyer dans la « course » habituelle.
Bertrand, médecin
L’épuisement au travail devient une expérience familière pour beaucoup de travailleurs. Dans de nombreux endroits, des moyens ont été mis en place pour aider cadres et employés à apprendre à identifier ce qui les épuise : formation à la gestion du stress, à la gestion du temps et des priorités, groupes de parole, entretien avec des psychologues du travail, cellules de soutien. Si tout cela est bon et aidant, encore faut-il être assez humbles pour reconnaître que nous sommes, autant que les autres, vulnérables au surmenage, et qu’il n’y a pas de mal à demander de l’aide. Les soignants sont le groupe le plus réfractaire à cette reconnaissance, car passer de la posture d’aidants à celle de demandeurs d’aide peut s’avérer délicat pour certains.
Notre signature d’un contrat de travail sous-entend qu’il nous est demandé d’être performants, de tenir les objectifs de notre poste ou de notre mission tels qu’ils sont décrits, avec les moyens matériels et humains mis à notre disposition. Pour cela, il nous est parfois demandé d’être innovants, de savoir gérer des crises, d’élaborer des solutions alternatives. Mais jamais de sauver le monde ! Je suis médecin et la longue formation que j’ai reçue insiste énormément sur la capacité du praticien à savoir discerner et acquérir le geste qui sauve. L’enjeu est sérieux : ce sont des vies que l’on confie aux soignants ! Il m’a fallu du temps pour réaliser que ce n’est pas le monde entier que l’on me demande de guérir, mais juste la personne installée devant moi. La difficulté où se trouve cette personne génère du stress en moi – stress bénéfique, dans la mesure où il stimule ma raison pour lui venir en aide de la meilleure des façons, et ainsi accomplir ce pour quoi j’ai été embauché. Ce n’est pas si simple quand la salle d’attente du cabinet ou des urgences est pleine, et qu’au stress du métier s’ajoute la contrainte du temps. Mais c’est un exercice bénéfique et aussi utile pour affronter les autres pressions de la vie. Si un certain stress peut devenir mon allié, il en est un autre que je dois apprendre à lâcher, parce qu’il est un ennemi : il nuit à ma capacité de relation et de travail et me détruit à petit feu.
C’est une question que nous abordons souvent dans notre équipe de travail, et nous recherchons continuellement à ajuster notre fonctionnement pour diminuer ce stress-là, essentiellement dû aux imprévus, toujours au rendez-vous dans notre métier. C’est tout un apprentissage personnel et collectif ! Nous avons, par exemple, changé deux fois l’aménagement de l’espace des consultations et des salles d’attente pour permettre de diminuer le stress de ceux qui attendent et de ceux qui sont attendus. L’architecture en dit long sur ce qui peut s’y passer : dans un couloir en longueur et des chaises en file, on ne peut qu’attendre, alors que dans un espace carré, avec des fauteuils tournés les uns vers les autres, tout autre chose peut survenir, et nous en faisons l’expérience tous les jours.
Mathilde, assistante sociale
Ce n’est pas peu de chose ce qui nous est demandé au quotidien. Il nous faut être efficaces au travail, au foyer, avec les enfants. Aujourd’hui, j’ai les moyens de me faire régulièrement aider pour les travaux de la maison, mais il fut un temps où tout nous revenait, à moi et à notre couple. Je suis assistante sociale et travaille dans le domaine de la famille. J’ai eu du mal à accepter de mettre la barre moins haut quant à la gestion de la maison. Ce sont paradoxalement les personnes que j’ai assistées dans mon boulot qui m’ont appris à leur insu de petites astuces toutes simples pour aérer mon emploi du temps : ne pas tout repasser, demander régulièrement de l’aide aux enfants pour décharger et ranger les courses, être plus détendue au sujet de l’ordre ou plutôt du désordre dans les chambres, oser confier les plus jeunes aux grands-parents pour une après-midi…
Les vacances de Noël ont souvent été un cauchemar. Mon époux est l’aîné de sa famille, et il est de coutume que le déjeuner de Noël se passe chez nous. La famille doublait d’un coup avec l’arrivée des beaux-parents, beaux-frères et belles-sœurs ! Il fallait que tout soit parfait – mais qui me l’avait dit ? Mes six enfants grandissant, les charges se sont multipliées. Grosse crise, heureuse crise ! Elle m’a aidée à sortir de la tentation de tout maîtriser et à permettre à chacun de mettre la main à la pâte. Durant les vacances, nous établissons des règles simples : les plus grands se chargent du barbecue du dimanche ; la vaisselle du soir se fait à tour de rôle ; chacun débarrasse son assiette plus deux objets sur la table ; le petit-déjeuner ne se prend pas après 10 heures et celui qui le prend en dernier fait un minimum de rangement en passant un coup de chiffon sur la table de la cuisine ; à la fin des vacances, nous prévoyons une journée familiale collaborative pour tout briquer et remettre en ordre. Petites choses, mais combien salutaires !
Pierre-Yves, ingénieur
Il arrive souvent qu’au seuil de l’entrée dans l’enseignement supérieur, nous ayons l’impression que le chemin est déjà tout tracé. Le marché du travail met en avant certaines filières, et parfois l’influence familiale double cette contrainte. Personnellement, j’ai eu peu à discerner et à choisir. J’ai fait des études d’ingénieur et je travaille depuis plus de quinze ans dans l’aéronautique. Mon travail a évolué. À présent, il m’est essentiellement demandé de faire du développement et de la recherche sur ordinateur. Malgré ma conscience ferme, graduellement acquise durant ces années en entreprise, d’être un maillon important de la chaîne de production et donc du service que propose l’entreprise, la question du sens de mon travail me taraude et me revient souvent à l’esprit. Il est certain que mon revenu assure une vie décente à ma famille, mais ma profonde insatisfaction m’est une grande source de stress.
Cette quête du sens m’a conduit vers des engagements associatifs. Là, je rencontre des hommes et des femmes qui s’interrogent sur le sens du vivre-ensemble, de la place des pauvres et des exclus dans notre société, et qui mettent leurs compétences au service d’un projet humanisant. Je ne veux pas dire par là que le projet de l’entreprise ne le soit pas, mais il me semble que nous le vivons dans la compétition et dans le souci premier de l’efficacité. C’est du reste pour cela que nous avons été embauchés. J’ai souvent réfléchi à une reconversion professionnelle, mais c’est un luxe que n’autorise pas l’environnement économique actuel. Je me résigne à consommer mon travail, ou plutôt à laisser mon travail me consommer, tandis que je vis mon bénévolat. Et je ne suis malheureusement pas un cas unique.
La consommation nous guette d’ailleurs continuellement. Durant les vacances, nous courons après les activités. Nos enfants nous y poussent, et nous ne supportons pas de les sentir s’ennuyer. Avec ma femme, nous nous sommes questionnés sur le sens du loisir à leur offrir. Nous avons trouvé une mesure humaine, il me semble. Nous prévoyons deux sorties exceptionnelles dans la semaine (spectacle de nuit, tour en bateau, parc d’attraction, nettoyage d’un cours d’eau, etc.) ; nous en parlons avant et après ; et nous proposons des activités autour de chaque sortie pour goûter le sens de ce que nous vivons et en faire un moyen de créer des liens : composer un album souvenir décoré avec le ticket d’entrée, faire le récit de la sortie avec paroles, dessins et photos, acheter des cartes postales à envoyer aux grands-parents, parrains et marraines relatant l’événement, etc. La question du sens est centrale dans la vie de chaque être humain, elle devrait le devenir pour l’ensemble de notre société, afin que nous arrivions à inverser la direction de la course à la consommation. Cette course déshumanisante est sans aucun doute une contrefaçon du repos.
Naziha, cadre en entreprise
On entend souvent dire que la vie devient difficile. L’est-elle aujourd’hui plus qu’autrefois ? Peut-être pas, mais elle l’est autrement. La même chose est dite du travail : si nous exécutons de moins en moins de travaux physiquement fatigants, nous nous épuisons dans la compétition sans mesure. La crise économique accentue la nécessité d’une concurrence entre groupes producteurs, mais aussi, de toute évidence, à l’intérieur des groupes en raison des menaces de réduction des effectifs humains et du danger de licenciement des moins efficaces. D’un autre côté, la dynamique de la maîtrise envahit nos vies et notre travail. Il faut tout prévoir, nos démarches doivent tendre vers le risque nul et, en tout cela, veiller à la sécurité ! Celle-ci devient le critère premier de nos choix collectifs et individuels. La vie devient synonyme de combat, ou du moins est-elle ressentie comme telle : combat engagé contre l’autre (collègue ou groupe concurrent), combat contre l’imprévu, combat contre le danger imprévisible, qu’il nous vienne de l’autre, des événements ou de la nature.
Je suis célibataire et cadre en entreprise, et je me refuse à entrer dans cette dynamique. J’estime que le seul combat légitime de ma vie est celui que je vis en moi-même en face d’un choix à poser. Je voudrais que ce choix aille toujours dans le sens de l’Alliance, et cela n’est pas toujours spontané. Choisir de continuer à considérer mon concurrent supposé comme un partenaire avec qui je peux engager une alliance ; choisir l’alliance dans l’imprévu qui surgit et me déplace, apprendre à composer avec cette nouvelle situation et à inventer quelque chose d’original qui peut parfois dépasser en richesses tout ce que j’ai pu imaginer ; alliance aussi avec cette part de risque qui sous-tend tous nos choix. Un combat, oui. Mais, dans le combat, choisir l’Alliance.
Nos milieux professionnels ont beaucoup à progresser dans ce sens pour éviter que nous nous épuisions au travail. L’ambiance de compétition et de recherche de performance fait que les cordons ombilicaux qui nous lient en permanence à notre supérieur hiérarchique, à nos collaborateurs, à notre binôme, ont tendance à se démultiplier. Par nos téléphones portables de plus en plus performants et connectés, la société de consommation nous offre tous les outils qui nous permettent au mieux de ne jamais décrocher de notre travail. Toutes les stations de ski, les stations balnéaires, les hôtels, les gîtes ruraux sont équipés de relais, et c’est parfois la condition sine qua non du choix de nos destinations de vacances. Quand vacances il y a ! Mes collègues disent ne pas décrocher et ne pas profiter de leurs congés. Certains avouent même ne pas en prendre. J’ai aussi succombé à tout cela les cinq premières années où j’ai travaillé, mais, aujourd’hui, j’essaie de planifier mes vacances à l’avance et paie des acomptes pour m’empêcher de faire marche arrière. J’ai trouvé un collègue de confiance à qui je peux confier la gestion des urgences de mon travail, et je gère les urgences de ses propres projets durant ses congés, et ceci crée une réelle collaboration entre nous tout au long de l’année. Durant les vacances, je m’impose de consulter mes courriels une fois par jour seulement, le soir. Ces petites règles m’aident à dire oui à l’alliance qu’est la vie, et qui attend que je m’y engage avec d’autres.
Frédéric, légiste
Une phrase de Storm Jameson a retenu un jour mon attention : « Je ne suis jamais plus heureuse que lorsque je suis seule dans une ville étrangère, c’est comme si j’étais devenue invisible. » J’aurais pu écrire cette phrase, je m’y retrouve parfaitement, et pourtant je ne suis pas un homme solitaire ! Normalement, je vis cela durant les vacances. Je pense que nous déployons continuellement beaucoup d’énergie pour nous construire une certaine image sociale et pour y rester fidèles. Me retrouver dans une ville étrangère me décharge de cette tâche et me repose. Je m’autorise alors à écouter ma tête et mon corps, à suivre leur rythme.
Mais faut-il aller si loin pour prendre du temps rien que pour soi ? Il est parfois difficile de trouver des moments et des lieux adaptés. J’ai appris, à mes dépens, à le faire. Ma femme et moi avons institué depuis plusieurs années, depuis que notre dernier enfant a quitté le foyer familial, un « week-end pour soi » une fois par mois. Chacun part de son côté ; je me retire dans la nature : mer, campagne ou montagne ; mon épouse va souvent à la découverte d’une nouvelle ville ou village, en éclaireuse pour nos vacances annuelles. Elle est croyante et se retire parfois dans un monastère pour « être visible à elle-même », comme elle dit. Ces week-ends nous font un bien fou. J’ai parfois l’impression d’en revenir plus vrai, plus ajusté, et peut-être l’image sociale que je me construis pourra-t-elle devenir, au fil du temps, ce que je suis vraiment.
***
Si le verbe « se reposer » provient étymologiquement de « pause » ou « arrêt de travail », il peut être satisfaisant à notre esprit de penser qu’il ressemble à se « re-poser », « se poser de nouveau » ou encore « prendre une posture nouvelle » – ce qui peut nous permettre de vivre plus à notre mesure dans nos lieux de travail et de détente. Des postures semblables à celles partagées par les quelque travailleurs dont nous venons de lire le témoignage, ou d’autres que chacun de nous peut chercher et trouver. N’avons-nous pas fait maintes fois l’expérience qu’un repos durable dépend en grande partie de notre capacité à travailler autrement ?