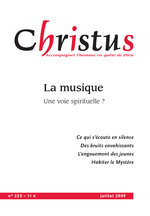Le déferlement des désirs, le cataclysme du désastre, l’émotion déchirante ; l’harmonie et la rigueur, une musique construite, calculée : voilà tout Alban Berg. Avec Schönberg, le maître, et Webern, l’ascète, Berg forme la seconde École de Vienne, héritière fidèle (parce que créatrice) de la première (Haydn, Mozart, Beethoven). Une vie brève : 1885-1935, qui se déroule toujours à Vienne et alentours, dédiée à la composition et à la défense de la Nouvelle Musique. Un catalogue restreint, voué au chef-d’oeuvre : les Altenberg- Lieder, les trois Pièces pour orchestre, la Suite Lyrique et surtout Wozzeck, l’opéra qui le consacrera tardivement comme ma tre de l’art lyrique, ce que confirmera Lulu hélas ! inachevé. Début 1935, le virtuose américain Louis Krasner lui commande un concerto, Berg s’engage dans la composition quand il apprend la mort, le 22 avril, à l’âge de quinze ans, de Manon Gropius, fille d’Alma Mahler, des suites d’une maladie foudroyante : il dédie son oeuvre à la mémoire de la jeune fille, y évoquant les facettes de sa personnalité et le cours tragique de son destin… Co ncidence étrange, lui-même mourra, le 24 décembre suivant, d’une septicémie, suite à une piqûre d’abeille que l’on avait négligé de soigner.
De cet ange, de notre terre trop tôt disparu comme fleur printanière, la partition de Berg interroge l’incompréhensible destinée. « Tout ange est terrible », affirme Rilke. Celui-ci l’est, de pureté virginale affrontée à la sauvagerie du Mal illégitime, mais – ainsi le saisira la méditation de Berg – finalement délivré de toute malédiction dans l’ultime transfiguration. La mémoire n’exorcise pas le passé endeuillé pour qu’il s’évanouisse et disparaisse dans l’arrangement du souvenir, mais elle le retranscrit en une
De cet ange, de notre terre trop tôt disparu comme fleur printanière, la partition de Berg interroge l’incompréhensible destinée. « Tout ange est terrible », affirme Rilke. Celui-ci l’est, de pureté virginale affrontée à la sauvagerie du Mal illégitime, mais – ainsi le saisira la méditation de Berg – finalement délivré de toute malédiction dans l’ultime transfiguration. La mémoire n’exorcise pas le passé endeuillé pour qu’il s’évanouisse et disparaisse dans l’arrangement du souvenir, mais elle le retranscrit en une